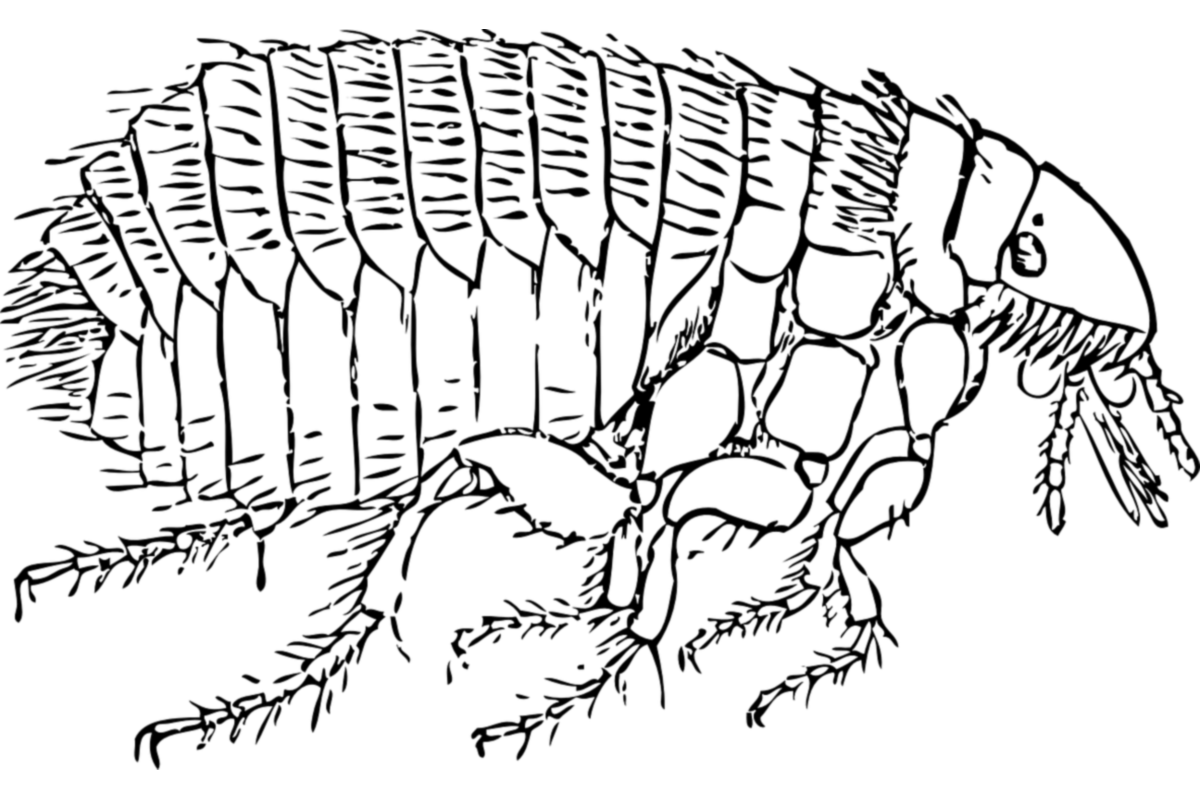La lumière du soleil atteint l’atmosphère terrestre et est diffusée dans toutes les directions par tous les gaz et particules présents dans l’air. La lumière bleue est plus diffusée que les autres couleurs parce qu’elle se déplace sous forme d’ondes plus courtes et plus petites. C’est pourquoi nous voyons un ciel bleu la plupart du temps.
La démonstration d’Isaac Newton
Un ciel clair et sans nuages le jour est bleu parce que les molécules présentes dans l’air diffusent la lumière bleue du soleil plus qu’elles ne diffusent la lumière rouge. Lorsque nous regardons vers le soleil au coucher, nous voyons des couleurs rouge et orange parce que la lumière bleue a été dispersée et éloignée de l’horizon. La lumière blanche du soleil est un mélange de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. Cela a été démontré par Isaac Newton, qui a utilisé un prisme pour séparer les différentes couleurs et ainsi former un spectre. Les couleurs de la lumière se distinguent par leurs différentes longueurs d’onde. La partie visible du spectre va de la lumière rouge avec une longueur d’onde d’environ 720 nm au violet avec une longueur d’onde d’environ 380 nm, en passant par l’orange, le jaune, le vert, le bleu et l’indigo. Les trois différents types de récepteurs de couleur dans la rétine de l’œil humain réagissent le plus fortement aux longueurs d’onde rouge, vert et bleu, ce qui nous donne notre vision des couleurs.
L’effet Tyndall
Les premiers pas pour expliquer correctement la couleur du ciel ont été faits par John Tyndall en 1859. Il a découvert que lorsque la lumière traverse un liquide clair contenant de petites particules en suspension, les longueurs d’onde bleues les plus courtes sont diffusées plus fortement que les rouges. Ceci peut être démontré en faisant briller un faisceau de lumière blanche à travers un réservoir d’eau avec un peu de lait ou de savon. Sur le côté, le faisceau peut être vu par la lumière bleue qu’il diffuse, mais la lumière vue directement de l’extrémité est rouge après être passée dans le réservoir. La lumière diffusée peut également être polarisée à l’aide d’un filtre de lumière, tout comme le ciel apparaît d’un bleu plus profond à travers des lunettes de soleil polaroïd. C’est ce qu’on appelle l’effet Tyndall, mais les physiciens l’appellent plus communément la diffusion de Rayleigh, d’après Lord Rayleigh, qui l’a étudiée plus en détail quelques années plus tard. Il a démontré que la quantité de lumière diffusée est inversement proportionnelle à la quatrième puissance de longueur d’onde pour des particules suffisamment petites. Il s’ensuit que la lumière bleue est diffusée plus que la lumière rouge par un facteur de (700/400)4 = 10 (environ).
Poussière ou molécules ?
Tyndall et Rayleigh pensaient que la couleur bleue du ciel était causée par de petites particules de poussière et des gouttelettes de vapeur d’eau dans l’atmosphère. Plus tard, les scientifiques se sont rendu compte que si c’était le cas, il y aurait plus de variation dans la couleur du ciel avec l’humidité ou les conditions de brume. Le cas a finalement été réglé par Einstein en 1911, qui a calculé la formule détaillée pour la diffusion de la lumière à partir des molécules… un résultat théorique qui a été jugé en accord avec l’expérience. Il a même été en mesure d’utiliser le calcul comme une vérification supplémentaire du nombre d’Avogadro en comparaison avec l’observation. Les molécules sont capables de diffuser la lumière parce que le champ électromagnétique des ondes lumineuses induit des moments électriques dipolaires dans les molécules.